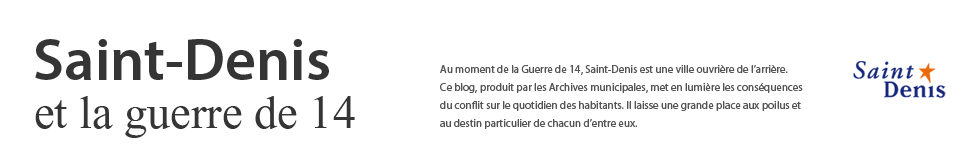« J’ai lu Gaspard, c’est bien mais je préfère Le Feu », c’est ce qu’écrit Maxime Chapuis le 3 mars 1918, dans une lettre à son meilleur ami. Ce jour-là, Maxime, soldat dionysien de la classe 1916, est sur le front depuis plus de deux ans. Curieux, avide de connaissances, il profite de ses moments de relâche pour lire aussi bien des philosophes des Lumières, comme Rousseau, que les best-sellers de l’époque, comme les deux ouvrages qu’il cite dans cette lettre.
Le premier d’entre eux, Gaspard, prix Goncourt 1915, est le premier roman publié sur la Première Guerre mondiale, un peu plus d’un an après le début du conflit. C’est le quatrième livre de René Benjamin, jeune auteur parisien mobilisé au 303e régiment d’infanterie. Il raconte le début de la campagne (d’août 1914 à février 1915 environ) du héros éponyme de l’histoire, Gaspard, un soldat « parigot », pittoresque et débrouillard. Malgré les difficultés, sa vision de la guerre reste souriante. Sa conclusion ? « Les Boches… ben les Boches, c’est toujours nous qui leur aura tanné la peau ! »
Paru au début de la guerre, le livre dépasse rapidement les 150 000 exemplaires vendus. Les combattants lui font très bon accueil, comme le lieutenant agrégé de lettres Marcel Étévé qui écrit le 4 janvier 1916 : « c’est la première chose vraiment bien que je lis sur la guerre. » Maxime, qui ne découvre le roman que deux ans plus tard, dans un contexte plus troublé, exprime toutefois un regret : René Benjamin ne parle pas de la guerre des tranchées, que les soldats subissent depuis septembre 1914.
Le vrai coup de cœur du jeune Dionysien, c’est donc le deuxième ouvrage qu’il cite, Le Feu. Un texte qui décrit la réalité du front. Son auteur, Henri Barbusse, pacifiste qui s’est volontairement engagé à 41 ans, a été soldat puis brancardier. Publié fin 1916, alors que civils et militaires sont de plus en plus las d’une guerre qui s’éternise, le roman, sous-titré « Journal d’une escouade », raconte le quotidien d’un petit groupe de soldats. Pas de héros ici, car, comme l’explique le narrateur, tous les combattants se ressemblent : « L’étroitesse terrible de la vie commune nous serre, nous adapte, nous efface les uns dans les autres. » Et cette vie, c’est l’attente (« on est devenus des machines à attendre »), le manque de ravitaillement (« pas pus d’confiture que d’beurre en broche »), les bombardements (« Une rapide lumière en face de nous, là-bas ; un éclair ; une détonation. C’est un obus ! »)…
Henri Barbusse « décrit la vie du front, mais c’est forcément un type qui l’a vécu pour la dépeindre ainsi, c’est d’un réalisme frappant comme langage et comme impression », s’enthousiasme Maxime. Mais certains accusent du coup l’auteur de représenter les combattants de manière trop dévalorisante. Et de faire preuve de défaitisme. Une polémique qui n’empêche pas son succès : en 1918, 200 000 exemplaires du roman ont déjà été vendus. C’est l’ouvrage de littérature combattante de l’époque le plus lu au front : de nombreux soldats se reconnaissent dans cette histoire qui tend à l’universel. L’un d’eux écrit même à l’auteur : « Votre Feu a été la révélation, le messie attendu. »[1] Maxime, plus modéré, adresse quand même un reproche à Henri Barbusse : « ne jamais parler des bons moments qui malgré tout existent tout de même. » Comme ceux que le jeune Dionysien a passé à lire le roman.
[1] BNF, fonds Henri Barbusse, MF 3042, lettre de Robert Carré, 23 novembre 1917. Cité par Benjamin Gilles, Lectures de poilus, Paris, 2013, p. 274.