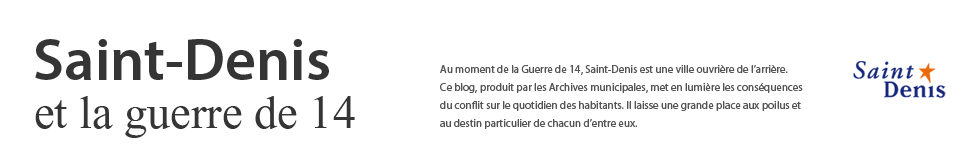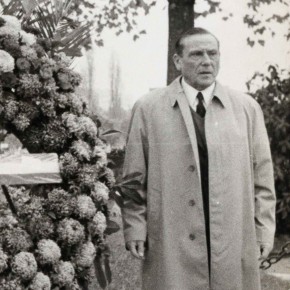 Auguste Persancier a grandi à Saint-Denis. Élu maire-adjoint en avril 1945 aux côtés d’Auguste Gillot, il restera élu communiste au conseil municipal pendant de nombreuses années.
Auguste Persancier a grandi à Saint-Denis. Élu maire-adjoint en avril 1945 aux côtés d’Auguste Gillot, il restera élu communiste au conseil municipal pendant de nombreuses années.
Dans son ouvrage intitulé Souvenirs de Saint-Denis, 1907-1986 (Ed. Imprimeurs réunis, 1985), il évoque les années de la guerre à Saint-Denis, alors qu’il était jeune écolier. Il raconte aussi comment il a vécu la mort de Jean Jaurès.
L’école dans la guerre
[…] Ma mère étant au lavoir, j’allais à l’école seul. Un jour, une fille m’a donné des galoches et j’ai aussitôt balancé mes souliers, je croyais bien avoir fait une affaire. Cela a fait du bruit à la maison. C’est l’un des rares souvenirs que je garde. L’école n’était pas vraiment mon truc. D’autant plus qu’à l’âge de sept ans, la première guerre mondiale est arrivée. Les écoles ont été occupées. La mienne, rue Franklin l’a été par le 1er zouave, caserné à Saint-Denis.
Ce régiment est parti au front ; il y eut peu de survivants. Leurs culottes rouges en faisaient des cibles parfaites. Ensuite, nous avons « hébergé » le 28e régiment d’infanterie. Les soldats dormaient dans l’école, sur de la paille. Ils y mangeaient. C’était, en fait, devenu une caserne.
En 1914, nous allions voir les soldats qui défilaient rue de Paris. Ils se rendaient, à pied, fusil sur le dos, à la gare du Nord pour prendre le train. Les commerçants leur donnaient tout ce qu’ils avaient. Le charcutier, en bas de chez nous, leur distribuait des conserves. Il y avait une solidarité formidable, une ambiance de fête. « Dans deux jours à Berlin ! » criaient-ils. Ils sont restés quatre ans dans la boue, décimés par l’une des plus grandes tueries que l’on ait connue, le crâne bourré des idées des marchands de canons. En Allemagne les mêmes gars scandaient « Dans deux jours à Paris »…
[…]
Nous nous déplacions souvent. Quand l’école de la rue Franklin était occupée, irrégulièrement, nous allions à celle de la rue du Corbillon. Pendant les bombardements, nous allions nous réfugier dans un souterrain qui, à l’époque, reliait le couvent des Ursulines à la Basilique.
J’étais à l’école quand eut lieu, en 1916, l’explosion du fort de la Double Couronne, je m’en souviens comme si c’était hier. On a cru un moment que c’était les Zepellins qui bombardaient. En fait, le dépôt de munitions du fort avait sauté. Il y eut des dégâts fantastiques. Le commissariat situé à côté du fort avait été complètement volatilisé, avec ses occupants. L’explosion avait été entendue à des kilomètres à la ronde. Les maisons de Saint-Denis n’avaient plus de carreaux. Un bloc de pierre de plus de cent kilos état même allé percuter la boulangerie de la rue de Paris qui existe toujours.Le projectile avait franchi près d’un kilomètre.
La ville était dévastée, les morts innombrables. Pour autant, je ne me laissais pas impressionnner. Chaque soir en sortant de l’école, j’allais récupérer, un peu partout, les morceaux de cuivre autour des obus pour les revendre quelques sous. C’était toujours ça de gagné.
Jaurès, L’Humanité…
En grandissant, je me rendais compte combien les petites gens avaient de difficultés pour manger, pour vivre, simplement. Mon beau-père m’a beaucoup aidé à prendre conscience des origines de ces difficultés, des moyens à mettre en oeuvre pour les résoudre. Je parlais avec lui, il me racontait la Révolution de 1917, ses grèves, ses luttes. Chaque fois qu’il y avait un mouvement, une revendication, il m’emmenait avec lui. C’est ainsi que, juché sur ses épaules, j’ai eu l’occasion à l’âge de six ans d’entendre Jean Jaurès, sur la butte rouge, au Pré-Saint-Gervais. Et l’assassinat du leader socialiste en 1914 est l’un des événements qui m’a le plus touché ; tuer quelqu’un qui lutte pour la paix, je n’arrivais pas à comprendre. C’est un souvenir qui restera à jamais gravé dans ma mémoire. Je revois encore son enterrement au mur des Fédérés, au Père-Lachaise. Il faisait nuit, nous étions des milliers à défiler, en silence, avec des torches. C’est quelque chose qui marque un enfant. Je n’ai jamais pu l’oublier.